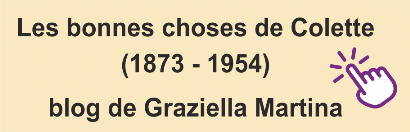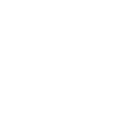Au mois de juin 1915, l’Italie entre en guerre aux côtés des Alliés contre l’Autriche et l’Allemagne. Le journal Le Matin, qui verra ses tirages augmenter jusqu’à un demi-million de copies grâce aux lecteurs avides de nouvelles de la guerre, envoie Colette, baronne de Jouvenel, à Rome, afin de décrire les répercussions de la guerre sur la vie quotidienne. «Qu’il est beau, ce versant des Alpes italiennes, – écrit-elle – arrosé d’eaux pures, fleuri, drapé de vignes, moiré de maïs, frais en dépit de l’été, chaud malgré la neige voisine!». L’émerveillement l’accompagne. Les forêts de pin rafraîchies par la pluie, les chutes d’eau, les rivières de montagne, les fleurs, les pâturages et les vignes suscitent son admiration. Elle découvre un peuple physiquement semblable à celui de sa Bourgogne, mais avec un bronzage plus intense. «Le soleil a bruni ceux-ci d’un hâle plus genereux ; des farines et des vins sans fraude dotent leurs femmes d’un sein plus riche, leurs enfants d'un estomac, d’une dentition plus robustes ; sauf cela, ils nous ressemblent.» Dans les gares, les bersaglieri partent pour le front et chantent et rient comme si c’était une fête, les officiers sont sur les quais et les troupes prennent le train. Ils rappellent à Colette les soldats français.
Elle arrive à Rome sous une pluie mélangée à de la grêle. À l’hôtel Excelsior, où elle doit séjourner, se trouve déjà une autre baronne de Jouvenel. C’est Claire Boas, le première femme d’Henry, qui, dans son salon parisien, avait organisé des rencontres diplomatiques pour préparer l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés des Alliés. Colette est traitée avec méfiance, comme une aventurière, et n’obtient pas sa chambre. Elle opte alors pour l’hôtel Regina, en face. Sa première impression de la capitale est celle d’une ville désertée par ses habitants à cause de la chaleur, contraints à l’oisiveté dès la brume matinale et lors de la vague de chaleur de midi, obligés de fermer leurs volets. Seule l’arrivée d’un léger vent d’ouest permet à la ville de reprendre ses activités.
Neuf heures du soir est l’heure des réverbères bleus à la lumière oxhydrique, qui donnent aux mains et au visage un aspect pâle et verdâtre. Au début, son séjour est rendu agréable par les bras accueillants de la ville, la belle langue qu’elle entend chanter autour d’elle, la foule chaleureuse qui se descend des glaces et des jus de fruits, tout en lisant la quatrième édition du Corriere della Sera. Mais un jour, alors que l’écrivaine est en train de regarder les beaux enfants, les femmes oisives, les vendeurs de fruits et de jus depuis une terrasse de Frascati, elle réalise que «plus loin que cette plaine et d’autres plaines, plus loin que cette eau, ce n’est pas encore la France…»
Il lui faudrait plus de trente heures de train pour regagner son foyer, pour revoir ceux qui comptent pour elle et avoir la certitude qu’ils se portent bien. Depuis ce moment, elle n’arrive plus à profiter des beautés qui l’entourent, comme le ferait n’importe quel touriste. Même un petit cimetière verdoyant près d’une église où elle se promène lui fait penser à son mari. Elle voudrait tant revenir ici avec lui, parmi ces grosses pierres réchauffées par le soleil. Elle va faire un tour dans les quartiers Gianicolo et Trastevere, où elle voit une place avec des petites maisons illuminées par le reflet des couleurs des tomates et des citrons plantés dans la bande de terre devant les façades. En compagnie d’autres Français, elle visite les marchés, où, à cause de la guerre, il n’y a rien d’intéressant. Au milieu des sommiers défoncés, des vieux abat-jours et des médaillons qui renferment les portraits de ceux qui sont partis pour la guerre, elle observe les marchands – surtout des femmes âgées, les hommes étant tous au front – qui mangent un plat de risotto accompagné d’un verre de vin. Pour surmonter sa crise, elle fait appel à son orgueil et à son sens du devoir.
Dans l’arrière-salle, qui est un jardin couvert, d’une trattoria du quartier de Trastevere, règne une odeur de safran et de vin frais. C’est ce qu’il faut à son ennui d’exilée.
Le soir, «la trattoria s’emplit d’une rumeur animale et bienfaisante, chaude de rire de femmes, de verres rudement maniés, de cris d’enfants. Car le petit ménage romain amène avec lui sa remuante progéniture, jusqu’au nourrisson, qui tette durant que sa mère vide un plat de spaghetti. À onze heures, les petits seront encore là, comme des moineaux éveillés, entre les tables… Le vin des Castelli reluit dans des ampoules de verre qui portent, enfoncé dans leur pâte épaisse, le petit sceau de plomb du contrôle. Cela est nouveau comme le lourd gâteau qu’on me sert et qui succède au poisson rôti ; tout est amusant pour les yeux, les mains et le palais» écrit-elle dans Les heures longues, livre qui contient une grande partie de son expérience italienne. A la fin du repas arrivent des joueurs de mandoline, qui lui provoquent des larmes de joie et une vive émotion lorsqu’ils jouent la Marseillaise.
Sur une place au bout d’une impasse se trouve une autre osteria où Colette aime s’attarder. «C’est une salle à boire, taillée dans la moitié d’une coupole byzantine. Elle s’appelle Basilica Ulpia, basse, vaste, parfaitement ronde. Sa muraille verticale est percée de portes, de caves, d’anciennes baies maintenant aveuglées. La courbe de sa paroi voutée s’illumine d’ampoules suspendues pleines de vin de Frascati rose, d’Orvieto jaune, de Chianti dont un seul point rutilant sur la panse décèle la couleur de sombre rubis. En colliers égaux, ces fiasques au col mince sont la seule parure de l’osteria, qui ne prend air que par une petite porte à rideau de toile. La mousse du Frascati mouille en pétillant nos narines ; on boit plus que l’on ne voudrait, à cause de la douceur du vin et des gateaux lourds, qui s’effritent dans la bouche en sable sucré. »
Dans ce restaurant on lui servait aussi des petits artichauts nouveaux. «Comme je ne parlais pas la langue du pays, je visitais mal la Ville Eternelle , et plus mal ses musées d’où je sortais écrasée et timide, rouée de chefs-d’œuvres. Je me nourrissais à des restaurants assez modestes, et celui de la Basilica Ulpia eut toujours de quoi me contenter, dès qu’il eut à me fournir, outre l’assiettée de pates, un monceau quotidien de petits artichauts nouveaux, saisis dans l’huile bouillante et raides comme des roses frites, elle raconte dans Flore et Pomone.
 Après le dîner elle va se promener le long du Foro romano , rebaptisé 'Forum des chats' ». Parfois, elle va dans d’autres auberges du quartier de Trastevere, en compagnie de Gabriele d’Annunzio. Elle lui montre des photos de sa fille, lui parle de l’héroïsme de son père et de son cher mari. D’Annunzio, dont le portrait dédicacé sera toujours sur le bureau de Colette, a l’impression que son époux la fait souffrir.
Après le dîner elle va se promener le long du Foro romano , rebaptisé 'Forum des chats' ». Parfois, elle va dans d’autres auberges du quartier de Trastevere, en compagnie de Gabriele d’Annunzio. Elle lui montre des photos de sa fille, lui parle de l’héroïsme de son père et de son cher mari. D’Annunzio, dont le portrait dédicacé sera toujours sur le bureau de Colette, a l’impression que son époux la fait souffrir. En juillet, Colette se rend à Venise. Même avec les fenêtres fermées, l’odeur estivale des canaux pénètre dans les maisons et coupe l’appétit. La ville, sous un ciel sombre et lugubre et sans touristes à cause de la guerre, semble fournir un effort de mimétisme pour se confondre avec l’eau. Les sacs de sable, sous lesquels la ville se cache, contribuent à rendre le décor irréel. Toutes les statues et les chefs-d’œuvre de la place Saint-Marc sont enveloppés et les chevaux de Lysippe sont emmurés. «Venise qui se cache sous le sable comme le poisson plat quand passent les mouettes». .. De jour, on entend les voix des femmes et des enfants ainsi que le tintement des services et des verres. De nuit, le silence et l’obscurité sont absolus et on se croirait dans une tombe. Il faut avancer à tâtons et il faut compter les colonnes pour s’orienter, tout en essayant de ne pas foncer dans les ombres noirâtres qui marchent dans l’obscurité. Le sentiment d’irréalité est complet. « Peut-être que je rêve – écrit-elle – peut-être qu’il n’existe rien à part le parfum de mon sorbet à la vanille.»
En septembre 1916, la revue La Vie parisienne l’envoie à Cernobbio, au bord du lac de Côme. Elle passe une seconde lune de miel au somptueux Grand Hôtel Villa D’Este avec son mari qui est venu la rejoindre. «Comme nous sommes bien à cet endroit ! Sidi, la sauge en fleurs, les convolvulus, l’eau qui ruisselle sur les escaliers, les figues mûres… je suis toute étourdie. » Elle écrit un passage patriotique en s’inspirant d’un défilé de mode parisien qui se déroule dans le hall d’entrée de l’hôtel, envahit de vêtements en tulle et de manteaux en peau de lapin, travestis en fourrure de renard couleur argent. Entre les déjeuners, les dîners, le thé de cinq heures, les hôtes fortunés essaient de faire passer le temps. Mais Colette trouve le moyen d’interpréter les préoccupations de ces femmes oisives, qui, en apparence, ne ressentent aucun sentiment de culpabilité avec la guerre. « Il suffit de les observer attentivement – écrit-elle – pour connaître leur pensée profonde, la seule qui frappe toutes les femmes en temps de guerre : attendre.»
Les époux Jouvenel retournent brièvement à Paris à la fin du mois d’octobre, juste à temps pour voir s’écrouler un coin de leur chalet suisse. Ce n’était pas une illusion d’optique, comme a pensé Colette en voyant la pluie passer à travers la salle de bain, le toit s’était bien écroulé. En novembre, ils déménagent au Boulevard Suchet numéro 69, à Auteuil, à deux pas du Bois de Boulogne. En décembre il se rendent de nouveau à Rome pour la conférence sur l’Entente à laquelle lui doit assister. Aristide Briand, premier ministre français, rencontre David Lloyd George, premier ministre britannique, pour trouver un accord avec lui avant l’arrivée des Américains. En hiver, Rome est d’une beauté incroyable, mais vivre dans un pays dont on ne parle pas la langue n’est pas si plaisant. La nourriture est rationnée, pas plus de quinze grammes de sucre, une noix de beurre et quelques tranches de pain par jour…
Alors elle va à l’ambassade d’Angleterre pour réciter ses Dialogues de bêtes et là elle peut avoir tout le beurre qu’elle veut, un beurre très frais, fait maison ! Seulement la salade italienne, composée de lard, de tomates, d’anchois, de mozzarella et d’olives ne lui plaît pas. « C’est un exemple à ne pas suivre à cause de l’abondance excessive de différentes saveurs qui ne se marient pas entre elles, au contraire, elles se heurtent » écrit-elle.
Cependant, sa vie à Rome n’est, dans son ensemble, pas si différente de celle du Boulevard Suchet. Au lieu de promener son chien au Bois de Boulogne elle le porte dans les jardins de la Villa Borghese et l’après-midi elle trouve refuge au Palatin, où elle cueille des bouquets de fleurs. Son mari repart, elle reste encore un peu de temps pour s’occuper du cinéma. Ils sont en train de tourner un film tiré de son livre La Vagabonde et la star est son amie Musidora, que le réalisateur trouve « trop italienne », il aurait préféré une blonde.

Le soleil tape et la chaleur dans les studios est étouffante. À midi, les bruits et parfums de la cuisine – des spaghettis avec une sauce à la viande - arrivent de la loge du gardien. Mais tant que le soleil est haut, il faut continuer à travailler. Elle reste sur le set pour expliquer aux lecteurs comment un film est réalisé.
Elle rentre à Paris à la fin de l’hiver. Elle envoie une copie de son journal intime italien à Marcel Proust. Il lui répond en disant avoir trouvé la description de Rome excellente. Il dit que quelques pages lui rappellent l’élégante prose de Bossuet du XVIIIème siècle.