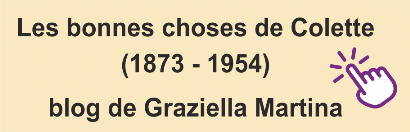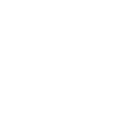Henry demande le divorce et Colette part pour le sud de la France, où elle présente une série de conférences et de spectacles. Le doux climat de la riviera niçoise, la mer et les fleurs donnent quelque peu de répit à ses conflits. Elle lutte contre la tristesse avec un appétit intentionnel, dirigé en particulier vers les fruits de mer. Mais la nourriture – le fameux rascasse frit, les plats parfumés à l’ail, au thym et à l’huile d’olive, le rosé accompagnant le melon, les pêches juteuses – ne suffit pas. Elle détourne ses pensées du boulevard Suchet car elle sait pertinemment que quand elle y retournera la maison sera vide et cela l’attriste profondément.
Manger est donc la seule façon d’oublier la douleur et de conjurer le mauvais sort. Quand elle rentre à la maison, elle évite la salle à manger, qu’elle prend soin de fermer, et elle apporte son repas dans sa chambre, sur un plateau. « C’est le casse-croûte des femmes seules » dit-elle. Elle passe l’été en Bretagne, à Rozven. « Le charme de la maison en brique donnant sur la plage déserte et les dunes de sable ne frappe pas au premier coup d’œil, c’est avec le temps qu’on l’apprécie » écrit-elle à sa mère. Elle va nager trois fois par jour et pêche des crabes et des crevettes. Parfois, il lui arrive d’aller pêcher la nuit, lorsque la lune est pleine. Elle arrache les mauvaises herbes du jardin et creuse des marches dans la colline à l’arrière de la maison. Malgré l’intense activité physique elle fait déjà plus de quatre-vingts kilos. Elle est une grosse tritonne et ses bourrelets sortent par les trous de sa chemise. « J’ai l’air d’un Gruyère en deuil » dit-elle. Elle joue à faire la matriarche avec ses invitées écrivaines. « Les hommes vont et viennent – écrit-elle dans son livre La Vagabonde – mais deux femmes unies l’une à l’autre n’imaginent même pas se séparer, elles ne font qu’un, elles souffrent comme un seul corps ».
Elle s’inquiète pour son beau-fils Bertrand qui manque d’appétit. C’est scandaleux qu’il n’ait pas faim au petit-déjeuner et qu’il refuse le rôti de canard froid ou la casserole de peau d’oie qu’elle lui propose. L’après-midi, avec la complicité de quelque pêcheur, Colette va voir les casiers à homards et elle en choisi quelques-uns pour embaumer le court-bouillon du dîner. Elle aime les dévorer baignant dans leur jus composé de vin blanc, d’épices, de beurre et de persil.
En mai 1921, lors d’un dîner chez des amis, elle fait la connaissance de Maurice Goudeket, de dix-sept ans son cadet, « jumeau de la Tour Eiffel ». Colette, « cheveux courts et ondulés, yeux malicieux et visage pointu », est vautrée sur le canapé. À peine s’assied-elle à table qu’elle prend une pomme dans le panier à fruits et en croque une morceau, amusée par l’effet produit sur ses voisins de table. Maurice a l’impression qu’elle en fait trop. Lorsqu’il la sert de vin, elle lui jette un regard de satisfaction. Ils se revoient sur la Côte d’Azur, puis dans l’appartement de Maurice à Paris, charmant mais froid. Suivent d’autres dîners, d’autres soirées à discuter, avec « des orgies d’eau minérale, d’oranges, de pamplemousses et de cigarettes ». Colette habite dans une petite mezzanine du Palais Royal qu’elle appelle le tunnel. Un de ses amis raconte que dans un appartement avec le plafond si bas la sole est l’unique aliment qu’on puisse manger. Le point positif est qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une échelle pour pendre les rideaux. Quand elle a de l’arthrite à cause du fort taux d’humidité, le médecin lui ordonne de partir. Alors elle s’achète une maison à Saint-Tropez et déménage à l’Hôtel Claridge, dans deux petites pièces au sixième étage, sur les Champs Elysées. Dans l’armoire murale, transformée en coin cuisine, elle se prépare de simples repas avec les légumes qui viennent de son jardin de la Côte d’Azur. Pour le dessert, elle mange des éclairs au chocolat. Les plats plus élaborés arrivent des cuisines du restaurant, après qu’elle a choisi ce qu’elle voulait sur le menu proposé par le chef. Parfois, elle descend dans le hall pour se mélanger un peu à la foule cosmopolite qui s’y trouve. Pour sauver les apparences, Maurice Goudeket habite dans la chambre à côté. Ils se marieront le 3 avril 1935. Les pieds de porc sont le plat principal du menu de noces.
« Le menu du déjeuner de noces ne mentit pas à ce moment hivernal du printemps. Il comportait de fondants jambonneaux de cochon cuits en pot-au-feu, habillés de leur lard rosé et de leur couenne, mouillée de leur bouillon qui fleurait un peu le céleri, un peu la noix de muscade, un peu le raifort et tous les sains légumes, serviteurs aromatiques de la maîtresse viande. Nous eûmes aussi des crêpes... Se marie-t-on sans champagne ? Oui, si le champagne s’efface devant une de cas rencontres qui ensoleillaient nos auberges françaises en l’espèce celle d’un cru anonyme, sombre et doré comme une chasse espagnole, et qui tenait le coup devant le cochon et devant le fromage … » racontera-t-elle plus tard dans L’Étoile Vesper.

Qu’est-ce que je ne vais pas manger à Marrakech ! » s’exclame-t-elle peu avant de partir en voyage de noce au Maroc. Elle s’imagine les fêtes des Mille et une nuit. La cuisine arabe – écrit-elle – est « comme un poème composé de cent plats … avec du lait aux amandes et le thé à la menthe pris dans les jardins illuminés par la lune, où poussent les roses, la menthe et le jasmin jaune et où murmure l’eau des fontaines recouvertes de mosaïques ». Le prince Al-Glawi, son hôte, a quatre-vingts cuisiniers à sa disposition et de nombreuses esclaves noires, « douces comme les fruits », qui s’occupent du service à table. Et, même si Colette a toujours privilégié la cuisine française traditionnelle, elle ne recule pas devant des plats venant d’autres pays.
« Dîner chez le chambellan du Sultan. Mosaîques et lumières mouillent à flots les mur. Belle à force d’être vaste, la demeure reçoit encore la lune, qui coule du haut de sa cour ouverte, oùï les eaux murmurent. Le dîner arabe commence par un potage poivré, puis nous avons :
La pastilla, feuilletée, aux œufs, et poulets sucré.
Les pigeons.
Le poulet aux amandes fraîches.
Le mechouï.
L’alose.
Le mouton recouvert d’olives et d’écorces de citrons.
Les fonds d’artichauts, posés sur une viande très cuite.
Du mouton, servi avec les pommes vertes cuites.
Le couscous aux raisins et pois chiches, avec le lait caillé.
Le turban du Cadi.
Les oreilles du Cadi.
L’orangeade sans eau.
Le café, le thé à la menthe.
Et, plus tard, le lait d’amandes. »
Voici la longue liste des plats de la cuisine marocaine que nous trouvons dans Prisons et paradis, livre dans lequel il est beaucoup parlé de cuisine. La pastilla est une pâte feuilletée farcie avec des morceaux de pigeon, du raisin et des amandes. Le mechouï est de l’agneau cuit en entier, à la broche, sur les braises du feu à bois. L’alose est un poisson qui ressemble aux sardines.
Dans le livre De ma fenêtre, il est aussi fait allusion à ce que l’écrivaine a mangé lors de son voyage dans le désert algérien. Elle goûte le lait aux amandes, dont la recette se trouve dans Prisons et paradis, boisson qu’elle ne quittera plus pour le reste de sa vie.
« Pour deux litres de lait d’amandes il faut plus d’un kg d’amandes fraîches et saines, épluchées. Pilez dans un mortier de marbre, avec une petite quantité de sucre. Ajoutez, goutte à goutte, l’eau nécessaire à l’émulsion. Pendant la nuit suivante, le mortier et son contenu, voilé d’un linge, resteront au frais. Le lendemain, filtrez, dans une poche de baptiste, ou de mousseline à trame serrée. Goûtez, sucrez, encore un peu, ajoutez la quantité d’eau qui manque encore à vos deux litres…
Ne frappez jamais le lait d’amandes, mais laissez flotter, sur son onde un peu bleue, crémeuse, une feuille de citronnelle verte, à peine émergée comme une jonque de Chine… Et n’oubliez pas non plus – tout est perdu sans elle ! – la goutte d’essence de rose, une goutte, une seule… »
Sur la terrasse de sa maison de Saint-Tropez, à l’ombre des glycines et des vignes, elle mange des spécialités provençales pour déjeuner : de la rascasse grillée, des raviolis de la mère Lamponi et du riz aux favouilles, ces petits crabes plats et verts, ramassés sur les rochers par les pêcheurs, le tout accompagné d’un rosé bien frais de la région. Les aubergines sont aussi à l’honneur, à peine récoltées dans le jardin, et sont préparées soit comme hors d’œuvre, mélangées avec d’autres légumes, ou bien simplement frites. Elle les appelle les karagheuziennes, du nom de Karagöz, personnage du théâtre d’ombres turc et protagoniste de bouffonneries qui, selon ce qu’écrit Théophile Gautier dans Constantinople, ressemble un peu à Polichinelle.
Ici aussi, comme à Paris, les repas de Colette commencent avec de l’ail, aliment privilégié parmi les saveurs rustiques, frotté sur une tranche de pain frais et légèrement saupoudrée de gros sel et termine par le dessert, de préférence des fruits.
Parfois, elle va pique-niquer. Elle aime être près d’une source d’eau, de pouvoir tendre le bras et remplir un verre ou bien simplement y déposer une bouteille de vin pour le maintenir frais, tout en ouvrant le panier plein de figues violettes et en coupant la tarte aux anchois.
Le soir, elle va boire un verre de vin blanc avec des amis au bal des pêcheurs ou alors elle se rend au petit restaurant du port. Elle fait honneur à la bourride, la soupe de poisson faite avec des rascasses, des grenouilles, du merlan, du loup de mer, du rouget et à laquelle on ajoute des têtes de poisson dans le bouillon de cuisson. Ou parfois elle mange le sotto coffi, comme elle raconte dans Journal à rebours.
« Ce poisson est fameux ! Comment l’appelez-vous ? Qui le sait ? Ici on l’appelle le sotto coffi. Derrière cette parure provençale, vous aurez reconnu le nom vulgaire de stockfish ? Moi j’ai mis du temps.»
Dans Prisons et paradis elle en décrit la préparation.
«En forêt du Dom, il est une auberge... Son renom se fait si vite qu'il n'est pas besoin de la désigner plus clairement. Le lieu est beau, en pleine forêt profonde, et la route romantique tourne à souhait pour l'attaque des diligences... Les soirs d'été, deux, trois tables rudimentaires, égaillées sous les acacias, attendent les amateurs de gibier, et les friands du poisson que j'appelle “le poisson au coup de pied”.
« Est-ce une recette? Non. Un accommodement culinaire primitif, vieux comme l’olivier, comme la pêche au trident. Jamais cuisson n'a demandé moins d'apprêts, il n'y faut que la manière.
Ayez seulement... une forêt provençale, tout au moins méridionale. Fournissez-vous-y de bois choisi : bûches cornues d'olivier, fagots de ciste, racines et branches de laurier, rondins de pin pleurant la résine d’or, menue broussaille de térébinthe, d'amandier, n'oubliez pas le sarment de vigne. A même la terre, entre quatre gros éclats de granit, bâtissez, allumez le bûcher. Pendant qu'il flambe, rouge, blanc, cerise, léché d’or et de bleu, il n'y a rien à faire que le regarder. Le ciel vert du crépuscule provençal, au-dessus de lui, tourne au bleu de lac.
Les flammes baissent, se couchent; vous avez sous la main, n’est-ce pas, une ou plusieurs belles pièces de poisson méditerranéen, tout vidé? Vous avez acquis à Saint-Tropez une rascasse monstrueuse, à gueule de dragon, ou vous avez apporté de Toulon les malins mulets à dos noirs, et vous n’avez pas omis, vidant ceux-ci ou celle-là, de glisser, tout le long de leur ventre creux, un fuseau de lard? Bon. Apprêtez votre balai, j’appelle ainsi ce bouquet odorant de laurier, de menthe, de pebredaï, de thym, de romarin, de sauge, que vous avez noué avant d’allumer votre feu. Apprêtez donc le balai, c’est-à-dire qu’il trempe dans un pot empli de la meilleure huile d'olive mêlée de vinaigre de vin – ici nous n'admettons que le vinaigre rose et doux. L'ail – vous pensiez naïvement qu'on pouvait se passer de lui? - pilé, jusqu'à consistance de crème, rehausse le mélange comme il convient. Du sel, peu, du poivre, assez.
Attention. Votre feu n'est plus que braises bientôt. Un lit épais de braises qui chante bas, des tisons qui flambent encore un peu; une fumée translucide, légère, porte à vos narines l'âme consumée de la forêt... C'est le moment de donner le magistral coup de pied qui envoie, au loin, bûches, brandons et fumerolles, qui découvre et nivelle le charbon ardent d'un rose égal, met à nu le cœur pur du feu sur lequel halète un petit spectre igné, bleuâtre, plus brûlant encore que lui.
Un vieux gril, à trois pieds hauts, salamandre tordue au service de la flamme, reçoit le poisson bénit de sauce, et le tout se plante d’aplomb, en plein enfer. Là!... Vous n’en êtes pas encore à la maîtrise de l’homme du Dom, l’homme de qui l’on ne voit que l’ombre sur le feu, le bras noir armé du balai aromatique, le bras noir sans cesse humectant, aspergeant, retournant le poisson sur le gril, pendant... Pendant combien de temps? L’homme noir le sait. Il ne mesure rien, il ne consulte pas de montre, il ne goûte pas, il sait. C’est affaire d’expérience, de divination. Si vous n’êtes pas capables d’un peu de sorcellerie, ce n’est pas la peine de vous mêler de cuisine.
Le “poisson au coup de pied” saute de son vieux gril dans votre assiette. Vous verrez qu’il est raide, vêtu d’une peau qui craque, s’exfolie et bâille sur une chair blanche, ferme dont la saveur se souvient de la mer et des baumes sylvestres. La nuit résineuse descend, une lampe faible, sur la table, dénonce la couleur de grenat du vin qui emplit votre verre... Marquez, d’une libation reconnaissante, cet instant heureux. »
Elle étale sur la table sous la treille l’aïoli sur les tranches de pain, alternant avec l’anchoïade. Elle termine le repas avec un bout de beau melon vert ou une tranche de tarte aux fraises des bois dont elle raffole et qu’elle va cueillir elle-même.
« Une légère onde de parfum conduit vos pas vers les fraises des bois, rondes comme des perles, qui mûrissent en secret, noircissent, tremblent, tombent et se décomposent lentement, dont l’arôme se mêle au chèvrefeuille verdâtre, qui est un mélange de miel et de champignons blancs. » écrit-elle dans Les vrilles de la vigne.
Elle nage, elle s’occupe du jardin, elle se promène et elle dresse même les papillons pour qu’ils viennent boire les gouttes de rosé sur ses doigts. « Comme c’est agréable de vivre physiquement et de sentir la force musculaire revenir alors qu’on la croyait perdue… ». Elle se rend compte qu’elle devient très méridionale. En été, elle se prépare des goûters composés de meringues farcies à la crème et de framboises.
Elle aime aussi faire des repas en plein air à Paris.
« Les jours attendris ne manquent pas, dès février. Nous prenions nos bicyclettes, un pain frais bourré de beurre et de sardines, deux ‘friands’ feuilletés à la saucisse, acquis chez un charcutier près de La Muette, et des pommes, le tout ficelé au long d’une gourde clissée, pleine de vin blanc… Pour le café, nous le buvions du côté de la gare d’Auteuil, bien noir, bien insipide, mais brûlant, et sirupeux à force de sucre.
Peu de souvenirs me sont restés aussi sentimentaux que celui de ces repas sans couverts ni nappe, de ces promenades sur deux roues. » se rappelle-t-elle dans Chambre d’hôtel.
Parfois, elle part pour des voyages gastronomiques dans des restaurants de province. Dans Bella-Vista, elle raconte une des ces expériences, dans son style inimitable.
« Dans la salle à manger, qui n’était point monumentale mais basse et soigneusement assombrie, une douzaine de petites tables égaillées, nappées de grosse toile basque, rassurèrent mon insociabilité. Point de beurre en coquille, point de maître d’hôtel en frac noir-verdâtre, point de porte-bouquets parsimonieux contenant un anthémis, une anemone fatiguée, un brin de mimosa. Mais un gros dé de beurre glacé, et, sur la serviette pliée, une rose de rosier grimpant, une seule rose aux lèvres un peu roussies par le mistral et le sel, une rose que je serais libre d’épingler à mon sweater ou de manger en hors-d’œuvre.
Entre les tables, Lucie, distraite, lasse et poudrée, portait l’omelette à la ciboule, la cervelle en beignets et la daube de bœuf.»
Parmi les voyages gastronomiques un peu particuliers figurent ses expéditions dans les bois pour se procurer la matière première d’un de ses plats préférés : les truffes, qu’elle voulait avoir servies dans la casserole avec leur jus parfumé.
Avec une petite truie en laisse, «une artiste unique en son genre», Colette va à la recherche des précieux tubercules, «joyaux d’une terre pauvre», qu’elle nettoie ensuite minutieusement une fois de retour à la maison, refusant de confier cette précieuse tâche à quelqu’un d’autre.
«Trop chère pour nous, la truffe du Périgord cédait la place, l’hiver, à la truffe de Puisaye, qui est grise, à peu près insipide, et dont le parfum abuse l’ignorant. Mais, grise ou noire, enfermez la truffe, brossée, dans une papillote de papier huilé, glissez-la, au devant du feu, dans une taupinière de cendre très chaude. Égrenez, au sommet du tumulus minuscule, de menues braises – l’inspiration, la légèreté de main aidant, vous exhumerez, une demie heure plus tard, des truffes pour la croque-au-sel.»
Ou bien :
«Elle ne vous donnera pas, une fois étrillée, grand-peine; sa souveraine saveur dédaigne les complications et les complicités. Baignée de bon vin blanc très sec — gardez le champagne pour les banquets, la truffe se passe bien de lui — salée sans excès, poivrée avec tact, elle cuira dans la cocotte noire couverte. Pendant vingt-cinq minutes, elle dansera dans l'ébullition constante, entraînant dans les remous et l'écume — tels des tritons joueurs autour d’une noire Amphitrite — une vingtaine de lardons, mi-gras, mi-maigres, qui étoffent la cuisson. Point d'autres épices! Et “raca” sur la serviette cylindrée, à goût et relent de chlore, dernier lit de la truffe cuite! Vos truffes viendront à la table dans leur court-bouillon. Servez-vous sans parcimonie; la truffe est apéritive, digestive.»
«Ne mangez pas la truffe sans boire. A défaut d’un grand ancêtre bourguignon au sang généreux, ayez quelque Mercurey ferme et velouté tout ensemble. Et buvez peu, s’il vous plaît. On dit, dans mon pays natal, que pendant un bon repas, on n’a pas soif, mais bien “faim de boire”.»
Colette déteste que les délicieux tubercules soient servis en tranches - « en copeaux » - ou émincés, à moins qu’ils ne servent à accompagner de la viande. Une partie du jus de cuisson est versé dans des verres à liqueur pour ensuite être bu.
En hiver, elle s’accorde parfois des vacances en montagne. C’est une façon de parler étant donné que pour elle, le mot vacance signifie souvent changer simplement de lieu de travail. À Gstaad, elle se met au ski, mais quand elle s’aperçoit que les culbutes, avec atterrissage sur le bas du dos, sont plus nombreuses que les tronçons de pistes parcourus, elle opte pour la table, où elle s’assied avec des amis venus la trouver.
Dans les années 40 Colette est désormais célèbre et elle est invitée en Allemagne, en Belgique et en Roumanie pour donner des conférences. Ce sont des tournées triomphales avec interviews, photos, banquets en présence de rois, présidents et ambassadeurs. À Bruxelles, après la cérémonie d’attribution de la Légion d’honneur, elle va dans les meilleurs restaurants de la ville avec ses amis, là où mange l’élite de l’Europe et où les meilleurs crus d’Europe sont servis. Mais encore une fois l’écrivaine provoque un scandale, tant par son apparence – elle est pieds nus dans ses sandales et les ongles vernis en rouge – que par sa requête de plusieurs bouteilles de Krieken-Lambic. En effet, c’est une bière populaire à base d’orge et de froment mélangés aux cerises Schaerbeck, qui se boit seulement dans les tavernes et qu’elle voudrait apporter à Paris.
À New-York, où elle est accueillie triomphalement, se déroule une scène curieuse. Au banquet officiel avec le maire Fiorello La Guardia sont présents 800 invités. Le carton d’invitation de l’écrivaine, qui apparaît sous le nom de Madame Goudeket, porte le numéro 799 et celui de Maurice le numéro 800. Colette, furieuse, refuse, peut-être pour la première et dernière fois de sa vie, de se rendre au banquet officiel et à celui des écrivains. Elle va faire un tour en ville.
Lorsqu’elle est contrainte de rester alitée à cause de son invalidité, elle fait en sorte que les saveurs de la campagne arrivent à son domicile.
« De l’ail, des oignons blancs, du gros sel, du poivre sur un fromage blanc à peine fait, du muscadet bien frais et des cerises… Faute de faire mieux, c’est une façon d’aller à la campagne. » écrit-elle.
Parfois, elle demande à Pauline de mélanger les oignons nouveaux avec le fromage de chèvre frais. Elle téléphone au restaurant Le Grand Véfour à l’étage au-dessous. Au signal du directeur Raymond Oliver, deux robustes plongeurs chargent sur leurs épaules une espèce de chaise à porteurs et vont la chercher pour la descendre au restaurant. Un jour, la mezzanine prend feu et la fumée envahit tous les locaux. Colette, intransportable, est bloquée par les flammes, mais ne perd pas son calme pour autant. « Ce n’est pas une bonne raison pour ne pas prendre le café » dit-elle. L’échelle des pompiers arrive juste à temps.
« Colette aimait les petits oiseaux. Certes elle avait une admiration pour ceux qu’elle voyait de son radeau. N’a-t-elle pas écrit Le moineau, ce piéton ? A ceux là elle ne voulait aucun mal. Par contre passereaux, alouettes ou ortolans, de préférence en forme de pâté, convenaient admirablement à son idée de la gastronomie. Car elle avait sur le sujet de belles et bonnes opinions que j’ai toujours respectée. » a écrit à son sujet Raymond Oliver, qui a transcrit la recette de sa tourte de mauviettes.
«Comptez six oiseaux pour deux. Il est difficile de faire des tourtes individuelles. Désosser entièrement les oiseaux et les mariner quelques heures en les assaisonnant, en les aspergeant d’armagnac jeune et émiettant quelques fleur de thym. Faire une farce avec porc, gras de jambon sec, volaille, en parties égales. Assaisonner avec un peu de quatre-épices, sel et poivre. L’assaisonnement doit être discret. Couper autant de dés de foie gras et de truffes qu’il y a d’oiseaux.
Préparer une abaisse de très bonne pâte soit feuilletée soit brisée pour le fond et feuilletée pour le couvercle. Opérer comme pour une tarte Pithiviers. Une couche de farce, les oiseaux farcis avec un dé de foie gras et un de truffe, disposés en couronne. Recouvrir de farce et de pâte. Bien sceller. Dorer au jaune d’œufs. Cuire 30 minutes à four gai. Laisser à four tiède 15 minutes, et servir. Vous pouvez accompagner d’une petite sauce ou tout simplement de crème de lait dans laquelle on aura ajouté un peu de beurre fondu. Le tout assaisonné et fouetté. »
Aimer les oiseaux – jusqu’à la fin de ses jours, elle n’a pas cessé de mettre sur le devant de la fenêtre de la nourriture pour les moineaux, de les observer dans le jardin, de s’apitoyer sur leur sort quand il y avait de la neige – et les déguster cuits dans l’assiette fut l’une de ses contradictions. En plus des petits oiseaux, elle aimait aussi beaucoup les poulets, comme celui à la cendre et à la glaise, dont elle parle dans Prisons et paradis.
« J’ai gardé pour la fin la recette d’un poulet à la cendre et à la glaise. ..Elle semble barbare. Elle rappelle celle du poulet chinois, scellé dans la laque, sauf que le poulet à la cendre demande qu’on l’englue, emplumé, dans l’argile lisse, la glaise des sculpteurs. Il ne faut que le vider avec soin, le poivrer et le saler intérieurement. Sa graisse, prisonnière, suffit à tout. La boule d’argile et son noyau gallinacé subissent une crémation assez longue au sein d’une cendre épaisse, de toutes parts entourée de braises qu’on attise, qu’on renouvelle. La molle argile, au bout de trois quarts d’heure, est un œuf de terre cuite. Brisez-le : toutes les pennes, une partie de la peau restent attachées aux tessons, et la perfection sauvage du tendre poulet vous incline vers une gourmandise un peu brutale et préhistorique … »
Le jour de ses quatre-vingts ans elle fait son dernier voyage gastronomique, très court, pour aller manger, dans le même restaurant, le lièvre à la royale, décrite dans Prisons et paradis.
« Laquelle d’entre vous se doute, lectrices, en savourant l’authentique ‘lièvre à la royale’, fondant, chaud à la bouche, que soixante – vous lisez bien soixante – gousses d’ail ont coopéré à sa perfection ? Un lièvre à la royale réussi n’a pas goût d’ail. Sacrifiées à une gloire collective, réduites à une consomption sans seconde, les soixante gousses d’ail, méconnaissables, sont pourtant présentes, indiscernables, cariatides qui soutiennent une flore légère et grimpante d’épices ménagères… »